La période électorale au Gabon a été marquée par une multiplication soudaine d’associations et de plateformes citoyennes se positionnant dans le débat public. Certaines affichent un soutien clair à des candidats, d’autres se revendiquent comme des espaces de mobilisation politique.
Mais ces structures sont-elles conformes au cadre juridique en vigueur ? Peuvent-elles librement mener des actions politiques sans être considérées comme des partis politiques ?
Qu’est-ce qu’une association et comment fonctionne-t-elle juridiquement ?
Au Gabon, une association est une organisation à but non lucratif regroupant plusieurs personnes autour d’un objectif commun. Elle est encadrée par la loi n°35/62 du 10 décembre 1962 qui impose une déclaration préalable auprès des autorités administratives pour qu’elle acquière la personnalité morale.
Une association non déclarée peut donc exister « de fait », mais elle ne peut signer de contrats en son nom, ouvrir un compte bancaire, recevoir des subventions publiques ou ester en justice.
Ce détail est essentiel dans le contexte actuel : la rapidité avec laquelle ces nouvelles structures ont émergé pose question. En effet, l’article 10 de la loi 35/62 dispose que « pendant un délai de trois mois à compter de la remise du récépissé provisoire, l’association ne peut exercer aucune activité à moins qu’elle n’ait reçu entre-temps le récépissé définitif délivré par le ministre de l’intérieur ». Or, les associations apparues entre février et mars 2025 sont, au mieux, soumises à un délai courant jusqu’en mai ou juin 2025. Ont-elles respecté ce délai de trois mois avant de commencer leurs activités ? Ont-elles toutes obtenu le récépissé définitif du ministère de l’Intérieur ? Si ce n’est le cas, alors elles agissent en dehors du cadre légal — ce qui soulève non seulement la question de la légalité de leurs actions, mais aussi celle de la provenance et de la légitimité des fonds qu’elles mobilisent.
Une association peut-elle mener des activités politiques ?
La question n’est pas anodine : pendant la période électorale, plusieurs associations ont agi comme de véritables structures partisanes, en soutenant ouvertement un candidat ou en influençant l’opinion publique. Cette réalité soulève un flou juridique qu’il convient désormais d’interroger à froid.
D’un point de vue strictement légal, la loi n°35/62 du 10 décembre 1962 relative aux associations ne précise pas le champ d’action des associations : elle impose un cadre formel (statuts, déclaration, récépissé), mais ne limite pas les types d’activités qu’elles peuvent mener. En théorie donc, rien n’interdit expressément à une association relevant de cette loi de s’exprimer sur des questions politiques.
Toutefois, la loi n°016/2011 du 14 février 2012, modifiant la loi n°24/96 du 6 juin 1996 relative aux partis politiques, établit une distinction nette. Son article 2 définit le parti politique comme une « association à but non lucratif (…) en vue de participer, par des voies démocratiques, à la gestion des affaires publiques ». L’article 3 précise que seuls les partis politiques et leurs groupements « concourent à l’expression du suffrage ». En comparaison, la loi du 10 décembre 1962 régissant les associations ordinaires ne confère pas à ces dernières la faculté explicite de participer à l’expression du suffrage. Cette différence marque une frontière juridique importante entre les activités autorisées aux partis politiques et celles des associations loi 35/62.
Cette compétence exclusive a des implications concrètes, notamment en matière de financement et de transparence. En tant qu’acteurs institutionnels de la vie démocratique, les partis politiques sont soumis à des règles rigoureuses : obligation de déclaration de ressources, contrôle des comptes, interdiction de certains types de financements, traçabilité des dons, etc. À l’inverse, une association déclarée sous la loi 35/62 échappe à ces exigences.
Dès lors, une structure associative qui aurait mené des activités à caractère politique pendant la campagne – en appelant publiquement à voter, en organisant des événements à visée électorale, en diffusant des messages de propagande ou en mobilisant d’importants moyens financiers – entre de facto dans le champ d’application de la loi sur les partis politiques. Même si la requalification juridique n’est pas expressément prévue par les textes, un principe de cohérence s’impose : on ne peut contourner les obligations imposées aux partis en se présentant simplement comme une association. Ce serait un détournement de régime juridique, avec des conséquences sur la légalité des actions menées.
En particulier, le maniement des fonds pose un problème sérieux. Une association qui collecte, utilise ou redistribue des fonds pour des actions politiques sans se soumettre aux obligations financières des partis agit hors du cadre légal. Cela ouvre la porte à des financements opaques, sans contrôle électoral ni responsabilité juridique.
Ce constat appelle une réflexion sur l’évolution du droit en vigueur :
- Faut-il créer une catégorie d’associations à objet politique, soumises à des obligations spécifiques, même si elles ne revendiquent pas la conquête du pouvoir ?
- Ou faut-il imposer que toute structure dont l’objet est d’influencer le suffrage ou de participer à la vie politique soit obligatoirement enregistrée comme parti, avec toutes les obligations que cela implique ?
Le vide juridique actuel a permis à certaines structures de mener des activités politiques sans en assumer les contraintes légales. Cette porosité entre cadre associatif et cadre partisan constitue un risque pour la sincérité du débat démocratique, en permettant un financement politique sans contrôle, hors des exigences de transparence et de responsabilité prévues pour les partis politiques.
Qu’en est-il des « plateformes » et unions d’associations ?
Certaines structures apparues récemment se revendiquent comme des plateformes, regroupant plusieurs associations autour d’un projet commun. Juridiquement, la loi n°35/62 prévoit bien l’existence d’unions d’associations, mais impose qu’elles soient déclarées auprès des autorités, comme l’indique l’article 14.
Toutefois, si une plateforme a pour objectif de peser directement sur une élection ou de structurer une force politique, elle pourrait être assimilée à un groupement de partis politiques. L’article 28 de la loi n°016/2011 définit le regroupement comme le fait pour au moins deux partis politiques déclarés de mener leur action politique au sein d’une structure commune tout en préservant chacun sa personnalité juridique.
Si une plateforme regroupe des partis politiques et agit en leur nom, alors elle relève de cette catégorie. Mais si elle rassemble uniquement des associations loi 35/62, elle ne peut prétendre au même rôle politique qu’un parti, sauf à être dans l’illégalité.
Conclusion : un flou juridique exploité en période électorale
La prolifération soudaine d’associations en période électorale soulève de nombreuses interrogations. Le droit gabonais distingue clairement les associations régies par la loi 35/62 des partis politiques, et toute structure qui chercherait à influencer directement un scrutin sans être enregistrée comme parti politique pourrait se retrouver en situation d’illégalité. D’où la nécessité d’exiger plus de transparence sur ces organisations et leur rôle réel dans le jeu démocratique.
Au-delà de leur régime juridique, c’est bien leur objectif qui interroge. La loi ne contraint pas les associations à une continuité dans leurs activités, mais cela ne saurait justifier leur instrumentalisation. Ont-elles été créées uniquement pour soutenir des candidatures ou promouvoir des messages partisans, en bénéficiant au passage de financements et d’une certaine liberté d’action, sans en assumer les responsabilités propres aux partis politiques ?
Aujourd’hui, alors que la campagne est achevée, une autre question se pose : que vont devenir ces structures ? Vont-elles disparaître aussi vite qu’elles sont apparues, révélant un engagement opportuniste ? Ou vont-elles, ce qui serait tout aussi préoccupant, se transformer subitement en partis politiques, comme pour régulariser a posteriori une activité partisane déjà exercée ? Une telle démarche inverserait la logique institutionnelle : on ne devrait pas devenir parti après avoir agi comme tel, mais bien adopter ce statut dès lors que l’on ambitionne de concourir à l’expression du suffrage.
Ce flou sur leur statut, leur temporalité et leurs intentions soulève des doutes sur la sincérité de certaines démarches. Il invite à une clarification du droit, afin d’éviter que le régime souple des associations ne soit instrumentalisé à des fins électorales, en dehors de tout cadre de transparence, de financement encadré et de responsabilité politique.
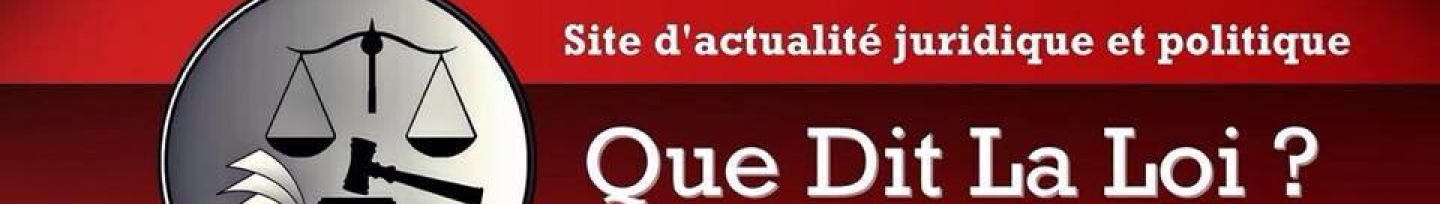
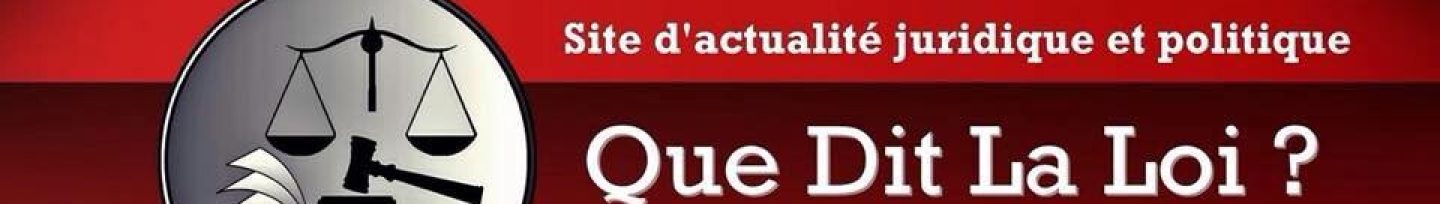







laisser un commentaire